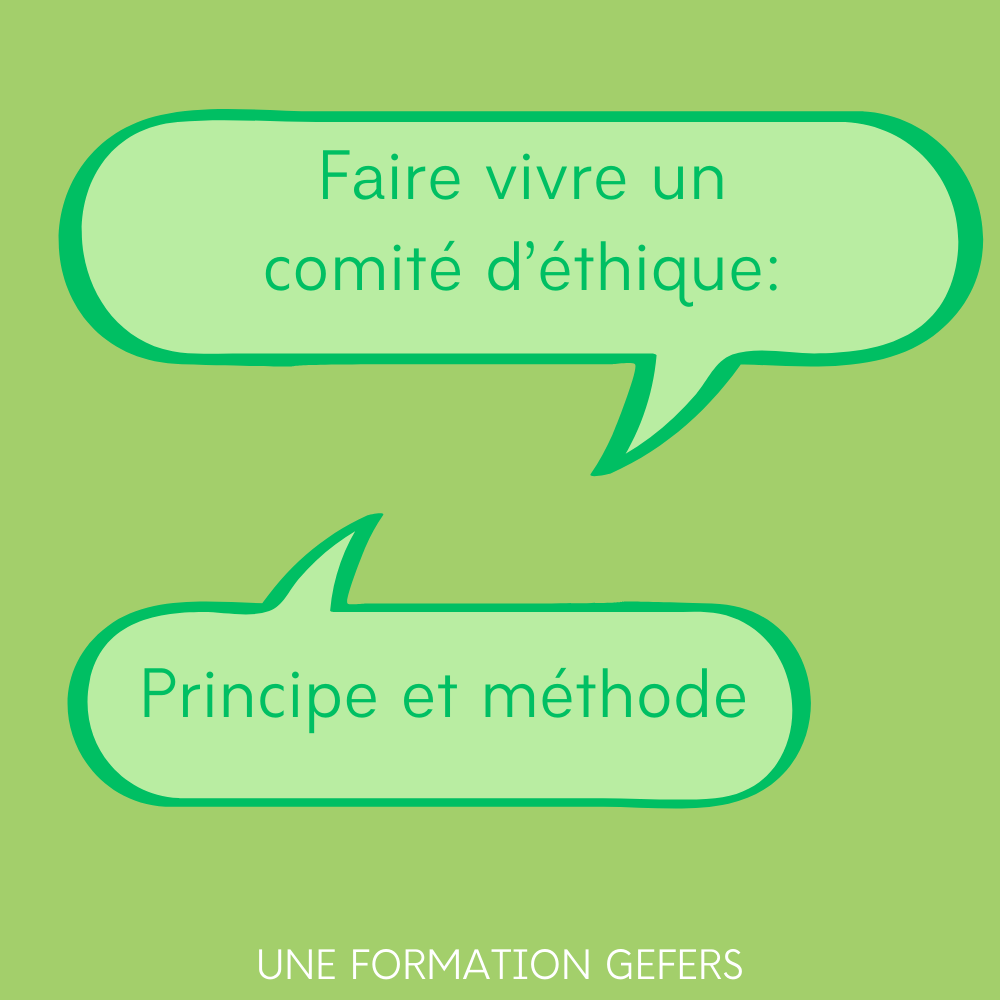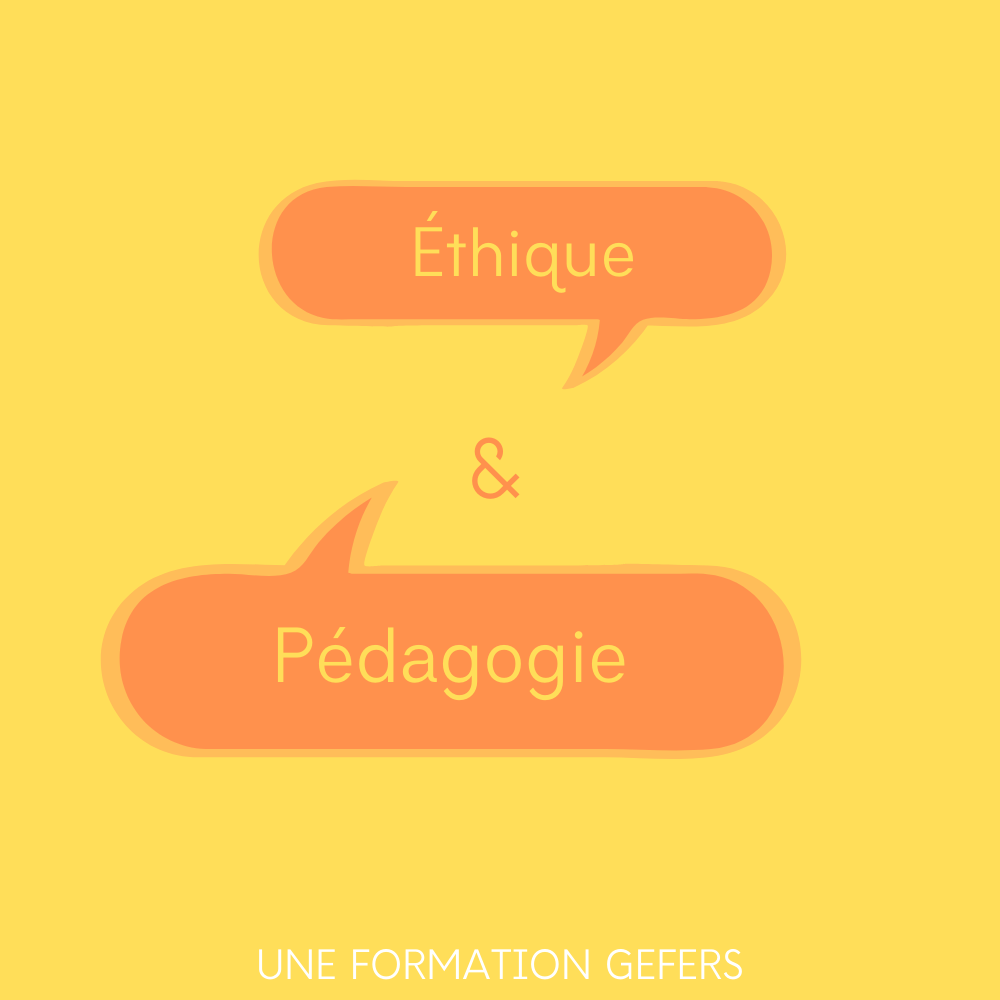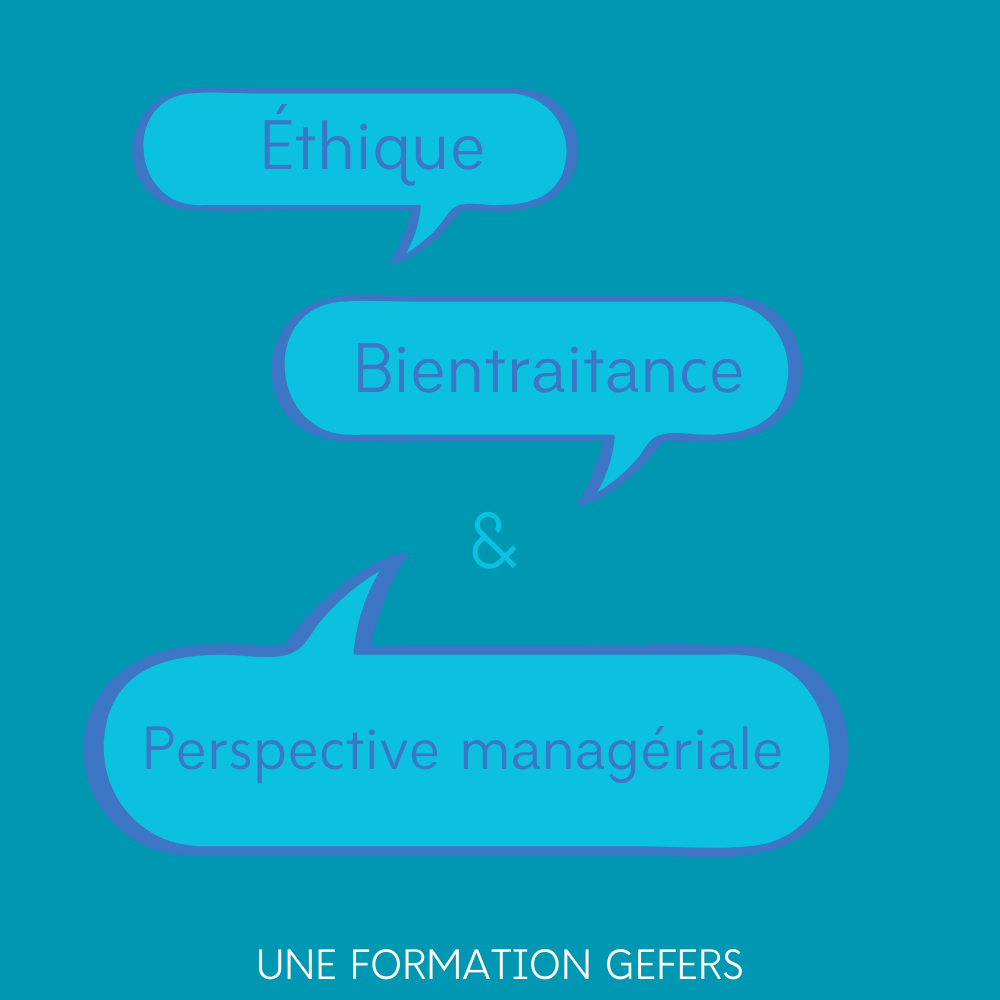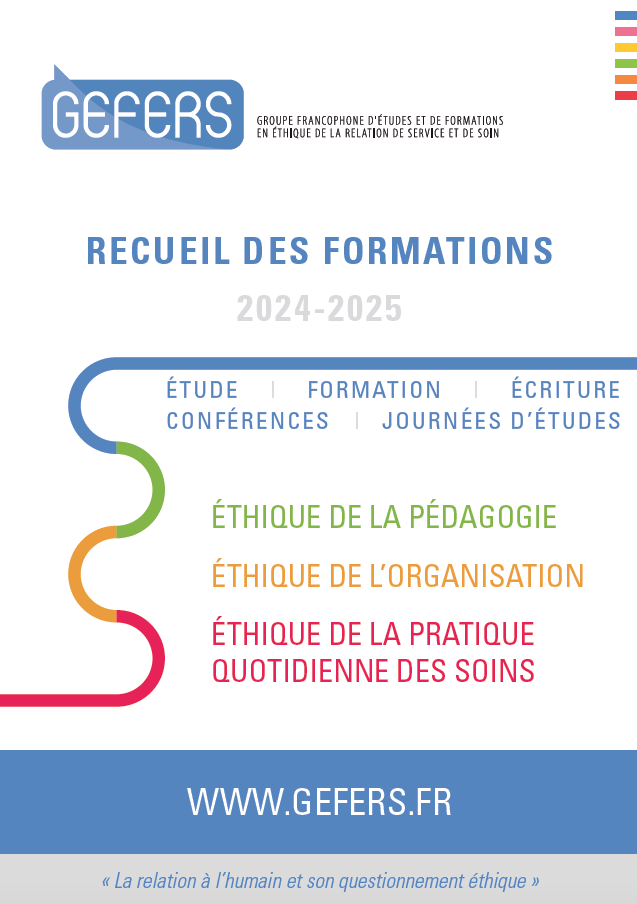Retrouvez plus d'informations sur les prochaines JIFESS
GEFERS Formation
GEFERS est l’acronyme de Groupe francophone d’Etudes et de Formations en Ethique de la Relation de Service et de soin, qui regroupe des professionnels issus d’un des métiers du service et du soin et expérimentés dans la formation.
Les activités du GEFERS ont pour point commun d’interroger, d’interpeller la relation à l’humain et son questionnement éthique et se déclinent en trois grands axes :
Celui de l’étude, pour élaborer de la pensée et proposer un regard critique sur telle ou telle question d’actualité
Celui de la formation pour accompagner les personnes désireuses d’augmenter, d’affiner ou de diversifier leurs capacités
Enfin, celui de l’écriture pour nommer d’une manière personnelle, préciser et diffuser les fruits de la réflexion.
Le GEFERS se propose ainsi comme un groupe impliqué dans l’étude, la formation et l’écriture.
Il est ouvert aux personnes intéressées par ce triple chantier et désireuses de s’y impliquer.
Recueil des formations
Le GEFERS organise ses formations soit au sein de votre établissement, soit dans le cadre d’un regroupement d’établissements dans le domaine:
– de l’éthique et de la pédagogie
– de l’éthique et de l’organisation
– de l’éthique de la pratique quotidienne des soins
Les événements à venir
XXVIIèmes JIFESS – Saint-Émilion
ENSEMBLE, BIEN VIVRE LE VIEILLISSEMENT: À LA MAISON, À L’HÔPITAL, EN INSTITUTION
Une éthique pour faire équipe d’accompagnement
Vieillir est un chemin absolument individuel mais n’est pas pour autant une affaire solitaire. Comme on ne peut naître, vivre ni survivre seul, on ne saurait vieillir sans la proximité d’autrui – celle des proches, des aidants, de certains professionnels.
Comme autrefois c’était une affaire de famille, aujourd’hui dans nos sociétés, vieillir est une affaire d’équipe. Que ce soit à la maison, durant un séjour à l’hôpital ou encore en institution.
Faire équipe pour bien vivre ensemble ce qu’il y a à vivre à l’occasion du vieillissement exige à la fois cohérence du projet d’accompagnement, organisation, ressources, clarté des valeurs poursuivies, reconnaissance de chacune et de chacun.
Quelques interrogations se présentent ainsi à notre réflexion :
- Quelles sont les valeurs primordiales qui orientent et balisent ces chemins du vieillir ?
- Quelles sont les difficultés concrètes ?
- Quels sont les impasses et les tabous ?
- Comment lutter contre les discriminations liées à l’âge et favoriser une inclusion sociale malgré le vieillissement ?
- Quelles spécificités éthiques et organisationnelles pour prendre en compte les personnes vieillissantes en situation de handicap ou de précarité ?
- Comment, dans un quotidien sous tension, maintenir ou raviver la motivation des équipes à œuvrer ensemble ?
- Quelles sont les conséquences du choix d’un lieu de vie inadapté à sa situation ?
- Quel est le regard de la société sur les professionnels du grand âge ?
- Quel est le point de vue des familles et quelles sont leurs attentes vis-à-vis d’une société-providence censée offrir l’accueil aux personnes devenues très dépendantes ?
- Quelles conséquences des progrès de la médecine, de l’environnement sociétal et de l’évolution des structures familiales sur la qualité de vie ?
Une fois encore, les enjeux de nos Journées sont à la fois éthiques, organisationnels et politiques et ils en appellent à un débat serein et authentique où le partage d’expériences concrètes a une part déterminante, à côté des apports plus théoriques.
Le Comité scientifique et d’organisation
Saint-Émilion (France)
21 et 22 mai 2026
Programme et inscription →
Pour une éthique de la continuité du prendre soin
Quelles valeurs partagées?
Quelle complémentarités?
Quelles organisations?
Quels outils?
Quelles formations communes?
Marseille (France)
12 et 13 novembre 2026
Programme et inscription →

La lettre du GEFERS
La Lettre du GEFERS est une publication périodique qui comporte trois grandes parties :
- un texte de fond présentant une réflexion sur un thème d’actualité,
- différentes informations relatives à nos activités et à la vie de GEFERS Association,
- la présentation de publications récentes.
L’historique des Lettres du GEFERS est téléchargeable dans l’onglet Publications du site.
GEFERS Association
GEFERS Association poursuit le but de favoriser et de promouvoir la relation à l’humain et son questionnement éthique dans les pratiques de service et de soin. Elle vise à questionner les manières d’être, de faire et de dire des personnes ainsi que les dynamiques organisationnelles en vue d’analyser et d’évaluer leurs impacts sur la relation de service et de soin.
Pour ce faire, l’association :
- favorise les échanges et rencontres entre ses adhérents par l’organisation de réunions et de séminaires de réflexion,
- élabore et publie La Lettre du GEFERS,
- organise une veille documentaire en vue de rassembler et de diffuser de l’information.